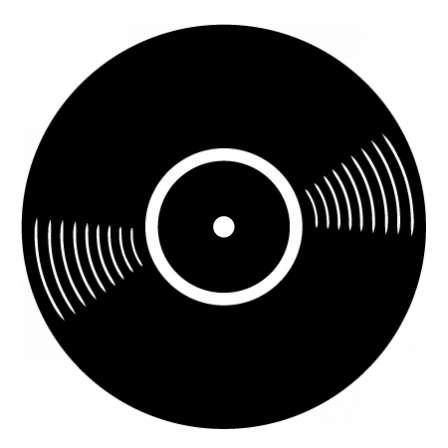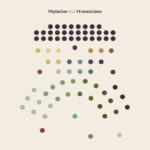L’histoire du pressage vinyle artisanal en Afrique de l’Ouest
Peu de formats musicaux racontent autant d’histoires que le vinyle africain. Dakar, Abidjan, Accra ou Lagos : ces capitales ont vibré au rythme des presses artisanales, véritables ateliers où la magie du groove s’est inscrite dans la cire noire. Des années 1950 aux premières décennies du XXIe siècle, près de 12 000 albums vinyles sont sortis des presses ouest-africaines, portant la voix d’artistes emblématiques, parfois méconnus à l’international. Plongeons au cœur d’une épopée artisanale, où la passion du disque a survécu aux aléas économiques et technologiques, tout en modelant une culture musicale unique.
Les débuts du pressage artisanal : entre débrouille et héritage colonial
L’Afrique de l’Ouest découvre les premiers vinyles dans les années 1950, alors que les indépendances pointent à l’horizon. Tout commence souvent par l’importation de disques européens, notamment via les réseaux coloniaux et maritimes. Mais très vite, un désir d’autonomie musicale naît, poussant certains passionnés à ouvrir leurs propres ateliers de pressage. À Accra, la légendaire usine Ghana Gramophone Company (plus de 1,5 million de disques produits jusqu’en 1980) devient pionnière du secteur, rapidement suivie par Côte d’Ivoire Disques à Abidjan et Societé Ivoirienne du Disque. Ces ateliers ne se contentaient pas de dupliquer : ils optimisaient les matières premières, contrecarraient les pénuries de vinyle brut (notamment pendant les embargos internationaux) et écoutaient soigneusement chaque pressage.
La technique restait artisanale : les matrices étaient gravées sur place, souvent avec des équipements rudimentaires. À Lomé ou Bobo-Dioulasso, il n’était pas rare que les studios utilisent des acetates usagés ou recyclent les disques rayés! Cette proximité avec la matière justifiait le soin accordé à la pochette – en carton, sérigraphiée à la main, elle devient pièce de collection recherchée des diggers actuels. Posséder un vrai vinyle original de Francis Bebey ou du Super Onze de Gao, c’est tenir entre les mains un objet qui sent la passion et la débrouillardise, loin des standards industriels occidentaux.
L’âge d’or : fusion des styles et explosion créative
Entre 1970 et 1985, la production atteint son apogée : plus de 300 nouveaux albums vinyles sortent chaque année entre le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Bénin. La rivalité entre labels tels que Disco Stock, Essiebons ou Satel offre un terrain d’expression inédit. Des groupes comme les Black Santiago, Gnonnas Pedro ou El Rego & His Commandos fusionnent traditions locales et influences occidentales, du highlife nigérian à l’afro-cubain, parfois jusqu’au funk psychédélique avec l’orchestre Poly-Rythmo. Les tirages restent modestes – souvent entre 500 et 3000 exemplaires par disque – ce qui explique leur rareté actuelle sur le marché international de la collection, où certains originaux dépassent les 800 euros pièce.
La dimension “objet” du vinyle prend ici tout son sens : chaque pochette peinte à la main reflète une identité singulière, chaque disque vieillit avec son lot de craquements et de surprise. L’écoute est active, attentive : on retourne la galette, on admire la sérigraphie, on découvre parfois des mentions manuscrites laissées par le producteur ou l’artiste. Dans les clubs de Bamako ou d’Accra, le DJ local sublime l’objet, le vénère. L’engouement traverse même les frontières lorsque les labels occidentaux – Analog Africa, Soundway ou Hot Casa aujourd’hui – rééditent ces trésors à destination d’un nouveau public.
Crise et résilience : le combat pour la survie du pressage local
La fin des années 1980 marque un coup dur : cassettes, CD puis téléchargement grignotent les parts de marché du vinyle. Beaucoup d’ateliers, souvent familiaux, ferment leurs portes. Au Nigeria, la mythique usine Polygram tourne au ralenti après avoir pressé près de 4 millions de disques en tout. L’économie locale et les crises politiques du continent fragilisent le secteur. Pourtant, certains artisans s’accrochent : la Sonic Press d’Abidjan survit jusqu’en 1999, tandis qu’à Cotonou et Accra, quelques presses clandestines continuent d’opérer pour des tirages confidentiels. La passion ne meurt jamais vraiment : la culture du sound system, la quête des DJ et le marché de la réédition insufflent par moments un regain d’activité.
Renaissance et valorisation patrimoniale : un nouvel âge d’or ?
Depuis une décennie, la vague “vinyle revival” gagne aussi l’Afrique de l’Ouest. À Lagos, Temitope Balogun remet en route des presses artisanales pour des petites séries de juju ou fuji, tandis qu’au Ghana, quelques curateurs redonnent vie à la Ghana Gramophone Company pour des éditions prestigieuses d’Ebo Taylor ou des “lost tapes” highlife. Cet engouement pousse à la redécouverte de pépites oubliées et dope le marché de la collection : en 2022, plus de 60% des rééditions “World” vendues en Europe sortaient d’enregistrements ouest-africains originaux ! Le vinyle n’est plus seulement un support : il se fait mémoire vivante des rythmes mandingues, yoruba ou akan, prête à tourner encore longtemps sur les platines des initiés. L’objet, dotée d’une plus value esthétique et sentimentale, continue d’irriguer la scène moderne et inspire des artistes comme les Analog Africa Band ou le Benin International Musical.
La prochaine fois que vous croisez une galette de Sir Victor Uwaifo ou de Sorry Bamba, tendez l’oreille : le crépitement du vinyle artisanal ouest-africain cache (encore) plus d’une histoire. Pour s’immerger pleinement, je recommande l’écoute sur platine de “L’Orchestre Volta Jazz” (discographie complète rééditée par Mr. Bongo), une plongée dans le groove mossi et l’univers coloré de Bobo-Dioulasso. Prendre le temps d’écouter, toucher, admirer, collectionner… le vinyle ouest-africain n’a pas fini de faire vibrer les mélomanes du monde entier.